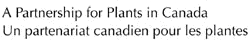Volume 10: Numéro
03
Octobre 2007
English
Newsletter

| Si vous désirez vous inscrire, avez des questions ou des suggestions ou si vous souhaitez contribuer au bulletin, SVP contactez Yann Vergriete, éditeur du bulletin ou David Galbraith, directeur exécutif du RCCF : yannvergriete@fastmail.fm dgalbraith@rbg.ca |
| 6. Bilan du 1er colloque sur la phyto-ingénierie au Québec, Jacques Brisson, Université de Montréal
Les toits verts, murs végétaux, marais filtrants et autres phyto-technologies connaissent un essor grandissant au Québec depuis quelques années. Le 18 juin dernier se tenait, à l'auditorium Henry-Teuscher du Jardin botanique de Montréal, le 1er colloque sur la phyto-ingénierie au Québec, organisé par l’Institut de recherche en biologie végétale (IRBV). Ce colloque avait pour principal objectif de faire le point sur l’utilisation de végétaux supérieurs comme méthode alternative aux technologies traditionnelles pour des fins d’amélioration de la qualité de l’environnement. Plus de 200 participants sont venus assister aux conférences des spécialistes sur les principes de fonctionnement, l’état des recherches et les réalisations québécoises en phyto-ingénierie. Après les mots de bienvenue de Gilles Vincent, directeur du Jardin botanique, Marie-Anne Boivin (Sopranature) et Owen A. Rose (Provencher, Roy et Ass., et Centre d’écologie urbaine) ont présenté des applications de toits verts au Québec et ailleurs dans le monde. Par la suite, Michel Labrecque (IRBV, Jardin botanique de Montréal) a démontré le potentiel d’utilisation des saules pour la décontamination des sols par la phytorémédiation. Pour finir la matinée, Pascal Bigras (Nature-Action Québec) présentait les diverses étapes de l’utilisation des végétaux pour la stabilisation des sols, suivi d’André Vézina (I.T.A., campus de La Pocatière), sur le pourquoi et le comment des haies brise-vent au Québec. Pour débuter l’après-midi, Sylvie de Blois (Université McGill) a démontré la capacité de certains couverts herbacés stables à inhiber l’établissement des arbres dans les emprises de transport d’électricité. Par la suite, Michel Labrecque revenait parler des saules, cette fois-ci sur leur potentiel d’utilisation dans les murs végétaux de bord de route pour limiter le bruit de la circulation automobile. Suivaient Florent Chazarenc (IRBV et École Polytechnique de Montréal) et Anne-Caroline Kroeger (Univ. McGill) qui sont venus parler de l’utilisation des marais filtrants pour l’épuration des eaux usées de diverses natures, comme les eaux usées de pisciculture (F. Chazarenc) et celles d’origine agricole (A.-C. Kroeger). Pour terminer la période des conférences, Danielle Dagenais (Université de Montréal) a présenté une synthèse sur les bénéfices indirects de l’utilisation des plantes en phyto-ingénierie sur l’environnement et sur la santé. Le grand nombre de participants au colloque témoigne de
l’intérêt grandissant de la phyto-ingénierie
et de l’importance d’une meilleure intégration
des différentes forces au Québec dans ce domaine.
L’organisateur du colloque, Jacques Brisson (IRBV, Université
de Montréal) cloturait la journée en présentant
un projet d’association québécoise sur la phyto-ingénierie.
Cette association aurait pour objectifs de promouvoir l’utilisation
d’approches de phyto-ingénierie, de faciliter la poursuite
de l’excellence dans ce domaine par la formation, l'information
et la recherche ainsi que de favoriser les échanges entre
les intervenants en phyto-ingénierie au Québec. Dès
l’automne 2007, un comité déterminera les dispositions
permettant la création officielle de cette association et
une campagne de recrutement sera amorcée. On espère
alors que, sous la bannière de cette association, le colloque
de phyto-ingénierie deviendra un événement
annuel à ne pas manquer.
|